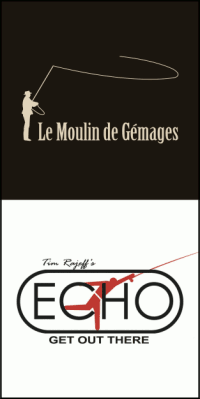mjpjp
Bonjour Gaetan, PEUX TU TE présenter ?
Je suis Ardéchois et actuellement directeur adjoint de la FDAAPPMA 07. Mon parcours a débuté avec une formation technique et scientifique qui m'a permis de rejoindre cette structure en tant que technicien. À 20 ans, j'avais déjà décroché ce qui était pour moi le métier de mes rêves, et, plusieurs années plus tard, cette passion est toujours intacte !
Au fil du temps, j'ai occupé différents postes au sein de la Fédération : technicien, chargé de développement, puis responsable du développement. Aujourd'hui, en tant que directeur adjoint, je suis également responsable de la communication et du développement, avec un focus particulier sur l’animation, la sensibilisation, et les projets de développement territorial liés à la pêche.
Si mes débuts étaient axés sur le terrain, mon rôle a beaucoup évolué. Je me consacre désormais à la gestion de l’organisation, au travail de fond pour défendre les intérêts des pêcheurs et des milieux aquatiques ardéchois, ainsi qu’à des stratégies de communication que j’ai développées en autodidacte. Mon quotidien se concentre davantage sur la gestion globale et la planification à long terme, même si des événements majeurs, comme la catastrophe écologique de cet automne, me rappellent l’importance cruciale du terrain.
Cette diversité de missions et d’enjeux continue de nourrir ma passion pour ce métier et pour la protection des écosystèmes aquatiques de l’Ardèche.
Nous allons aborder dans cette interview la vidange du barrage du Cheylard survenue l’automne dernier qui a engendré une forte mortalité piscicole. Peux-tu nous présenter le coin ?
Nous nous situons dans la vallée de l’Eyrieux, l’un des plus importants bassins versants du département. Cette rivière prend sa source sur les contreforts du Massif Central, dans les zones humides et tourbeuses situées près de Saint-Agrève. En aval, l’Eyrieux plonge dans des gorges à hauteur de Saint-Martin-de-Valamas. À ce niveau, elle est classée en première catégorie avec une gestion patrimoniale, peuplée principalement de truites fario sauvages et d’espèces accompagnatrices.
Plus en aval, nous atteignons le célèbre barrage situé sur la commune du Cheylard, au milieu du bassin. Ce barrage marque la transition entre la première et la deuxième catégorie piscicole. Le débit de l’Eyrieux s’est considérablement renforcé en amont de la retenue grâce à l’apport de trois affluents majeurs : la Rimande, l’Eysse et la Salliouse. Ces affluents jouent un rôle clé, notamment dans le transport sédimentaire, un point qui revêt une importance particulière pour la suite de notre entretien.
En patois, "Salliouse" signifie "eau sale" — un nom qui illustre bien la nature de ce cours d’eau, principale source de sable pour l’Eyrieux. Ensemble, ces affluents apportent environ 40 000 m³ de sédiments dans le barrage chaque année. Résultat : la retenue s’est rapidement colmatée depuis sa mise en service. Ces dernières années, à la cote maximale du barrage, on ne mesurait souvent plus que 6 à 7 mètres d’eau, alors que le mur du barrage atteint une hauteur de 25 mètres !

Concernant l’ouvrage lui-même, quelle est sa raison d’être et son propriétaire ?
Le barrage de Collanges est un ouvrage emblématique, mais aussi controversé, de la vallée de l’Eyrieux. Construit entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, il illustre les ambitions et les écueils des grands projets d’aménagement de cette époque. Géré aujourd’hui par le syndicat de développement d’aménagement et d’équipement de l’Ardèche (SDEA), avec une concession hydroélectrique attribuée à la CN’aire, filiale de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR), il a initialement été exploité par EDF.
Le barrage de Collanges devait répondre à plusieurs objectifs :
- Constituer une réserve d’eau agricole pour soutenir les activités agricoles locales
- Développer le tourisme autour du Cheylard avec des activités nautiques et un potentiel immobilier.
- Produire de l’électricité, avec une centrale hydroélectrique.
- Assurer un soutien d’étiage, bien que cet usage soit secondaire.
Cependant, la régulation des crues n’a pas été prise en compte dans sa conception. Entre le début des études en 1970 et la mise en œuvre dans les années 1980, un décalage d’une décennie a exacerbé des contradictions ! Par exemple la baisse des besoins en irrigation due à la maladie de la sharka. Dans les années 70, la vallée de l’Eyrieux était le berceau des pêches et des abricots en France mais suite à cette maladie sur les prunus, l’arrachage subventionné des pêchers a transformé le visage agricole de la vallée. Aujourd’hui il reste une centaine d’agriculteurs.
Ce n’est pas tout, le barrage a été construit au prix de l’expropriation de 40 hectares de terrains agricoles alluviaux, suscitant des oppositions du monde agricole dès 1978. Les études préalables, menées de 1978 à 1981, se sont contentées de présenter les bénéfices économiques de l’ouvrage, avec peu d’attention portée aux impacts environnementaux ou au transit sédimentaire.
Et le plus important, la présence d’une ancienne décharge publique dans le périmètre de la retenue posait déjà problème. Les industries locales (tanneries, bijouteries, industries textiles et chimiques) rejetaient directement leurs effluents dans l’Eyrieux.
En mai 1980, un arrêté préfectoral conditionnait la mise en eau à deux impératifs :
- La création de 12 stations de traitement des eaux usées en amont.
- L’évacuation et le traitement de 40 000 tonnes d’ordures domestiques et industrielles, y compris des fûts contenant des substances toxiques.
Face aux coûts élevés, le SDEA a opté pour une solution minimaliste : l’enfouissement des déchets sous un film goudronné. Cette méthode, mise en œuvre en 1982, n’a pas inclus de traitement des lixiviats ni d’assainissement des eaux usées. En avril 1983, la retenue a été mise en eau, suivie d’un arrêté préfectoral interdisant la baignade pour des raisons de sécurité et de santé publique. Ce coup de grâce a définitivement enterré la vocation touristique de l’ouvrage dès sa mise en eau !
De 1983 à 1988, la retenue a reçu des effluents industriels non traités des vallées environnantes. La station d’épuration, construite en 1988, n’a pas permis de traiter efficacement tous les rejets. Des conventions signées avec les industriels ont même prolongé les déversements dans le lac, aggravant la pollution de ses sédiments.
Les années de pollution industrielle et l’accumulation de sédiments dans le lac ont laissé un héritage complexe. Avec environ 40 000 m³ de sédiments apportés chaque année par les affluents amont, le barrage de Collanges témoigne des erreurs de conception et de gestion passées. Ce "cocktail" de déchets enfouis et d’effluents chimiques continue d’impacter durablement l’écosystème de l’Eyrieux.
Le barrage, initialement perçu comme un levier de développement économique et touristique n’était peut-être qu’un mensonge déjà à l’époque ?

Le problème des sédiments ne semble pas dater d’hier, pourquoi les élus actuels ont pris le taureau par les cornes ?
Tu sais, la vidange d’un barrage comme celui des Collanges aurait dû être réalisée tous les dix ans. À l’origine, la vanne de fond devait permettre ce passage de sédiments. Problème, puisque la vanne de fond est restée fermée pendant 30 ans car colmatée dans les premières années de fonctionnement du barrage. Tu ajoutes à cela le cocktail polluant situé sous le barrage et du coup tu comprends pourquoi on n’a rien fait pendant quarante ans ! Les différentes majorités au département ont bien compris que c’était plus facile de repousser le problème. Résultat, on a accumulé 1,6 million de m³ de sédiments dans la retenue, ce qui limite aujourd’hui sa capacité de stockage (à seulement 1,55 million de m³) et la production électrique.
Dès 2001, le Syndicat Départemental d’Équipement de l’Ardèche (SDEA) se retrouve contraint de rétablir le transit sédimentaire pour respecter la législation sur l’eau. Le fonctionnement de la vanne de fond est rétabli en 2013... Depuis 2014, une série d’arrêtés préfectoraux autorise l’ouverture de cette vanne lors de crues supérieures à 100 m³/s et impose sa fermeture lorsque le débit redescend en dessous de 80 m³/s.
Cependant, ouvrir la vanne de fond ne suffit pas à compenser trois décennies d’accumulation de matériaux. Les sédiments présents dans la retenue posent des problèmes complexes : leur volume est colossal et certaines couches sont polluées, rendant leur restitution directe à la rivière impossible. Cela nécessite des études approfondies pour cartographier et caractériser ces sédiments avant toute action.
En 2016, dans le cadre du contrat de rivière "Eyrieux Clair", plusieurs scénarios sont élaborés avec les contributions des élus et techniciens de la Fédération :
- SCÉNARIO 1 : adaptation de l’exploitation et ajout de vannes de fond,
- SCÉNARIO 2 : curage de la retenue, réinjection dans l’Eyrieux et évacuation ou valorisation,
- SCÉNARIO 3 : dérasement du barrage avec aménagement préalable de la retenue,
- SCÉNARIO 4 : arasement du barrage et modification de la vanne de fond.
Nous, à la FDAAPPMA 07, nous sommes battus avec les associations environnementales pour inclure l’effacement du barrage dans les scénarios. Pour nous, c’était et c’est toujours la meilleure option, à la fois écologiquement et économiquement.
Depuis quelques années, la préfecture a intensifié la pression sur le département pour gérer ces sédiments. En 2022, mise en demeure du SDEA, par arrêté préfectoral du 15 décembre 2022, de rétablir le transit sédimentaire de la rivière. L’article 17 de l’arrêté précise que :
« Une solution partagée pour rétablir le transit sédimentaire devra être mise en œuvre en concertation nécessaire avec les acteurs du territoire ». Partagée…. La blague !
Ils avaient trois ans pour choisir une solution et deux de plus pour la mettre en œuvre, mais en seulement 21 mois, ils ont choisi et réalisé une « vidange expérimentale ». Franchement, c’est une décision trop hâtive et avec trop peu de concertation !
En amont de la décision, le SDEA a organisé quelques réunions de concertation, mais seulement avec nous et le syndicat de rivière. D’autres acteurs majeurs, comme le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche ou les associations environnementales, n’ont même pas été consultés, alors qu’on est en pleine zone Natura 2000 ! Nous, on a exprimé nos craintes dès le départ. On a demandé à réaliser nous-mêmes le suivi des frayères à truites et des matières en suspension, mais tout a été rejeté. Le département a commandé une étude indépendante au cabinet Antea Groupe, et leurs conclusions étaient franchement étonnantes. Pour te donner un exemple, ils identifient 100 m² de frayères potentielles sur 10 km en aval, alors que nous, on en compte 6000 m² !
Pourquoi c’est important ? Parce qu’à partir de 200 m² de frayères, le dossier passe sous un régime d’autorisation, ce qui change radicalement la demande auprès des services l’état, bien plus contraignante. Leur sous-estimation a permis de valider le protocole rapidement. On a tenté de faire modifier ce protocole directement avec le SDEA, puis fait un recours gracieux auprès de la préfecture. Tout a été refusé. Nous avons déposé un référé auprès du tribunal administratif de Lyon, mais nos arguments n’ont pas été retenus. Nous ne sommes pas experts aux yeux du juge du TA, mais la DDT !
Tu vois, on se bat tous les jours à la FD pour défendre les pêcheurs et les milieux aquatiques, mais c’est là que tu comprends qu’on a un travail énorme en FD sur ce rôle d’expertise et je pense que notre passé de fédération de pêche et de pisciculture nous dessert, on est clairement pas pris au sérieux… est ce qu’on manque de compétences techniques en FDAAPPMA ? est-ce que la qualité de nos rapports scientifiques n’est pas suffisante aujourd’hui pour être crédible en tant qu’expert ? nous sommes experts et avons en interne des spécialistes, des hydrobiologistes donc…nous devons capitaliser sur cela
Lobbying, magouille et compagnie ?
Des questions se posent :
- La préfète a-t-elle vraiment eu tous les éléments pour signer un tel arrêté ? l’a-t-elle bien signé, elle ?
- Quel sérieux accordé au bureau d’étude auquel le SDEA a fait appel, avec son dossier loi sur l’eau ?
- Pourquoi la DDT est-elle si laxiste ?
- Quel crédit apporter à une vidange « expérimentale » impactant pour le milieu ? n’est-ce pas plutôt un moyen d’arriver à ses fins sans engager ses responsabilités ?
Une enquête est en cours qui déterminera les responsabilités de chacun dans cette vidange expérimentale vouée à l’échec !

Comment le département a-t-il « vendu » cette affaire à la population ?
Pour situer le contexte, le président du département est également vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en charge de l’agriculture. Aujourd’hui et en résumé, la marque de fabrique de la communication départementale, c’est de mettre en avant la "ruralité" et le monde agricole.
Le barrage représente une opportunité politique idéale pour valoriser l’action publique, surtout que, depuis 40 ans, toutes les majorités départementales se sont refilées cette patate chaude sans jamais vraiment agir. Cette fois, ils ont promis d’intervenir pour augmenter la capacité de stockage du barrage, prétendant que c’était indispensable pour sauver le monde agricole et éviter que les agriculteurs ne mettent la clé sous la porte. C’est comme cela que le projet a été présenté : un geste pour l’agriculture, un soutien à la ruralité.
Mais derrière cette façade, rien n’a été expliqué en détail. Il n’y a eu aucune transparence, pas même une lettre d’information adressée aux habitants ou aux communes directement concernées. Le manque de communication a été énorme, ce qui a alimenté l’incompréhension et les tensions. Une telle gestion ne fait qu’aggraver le fossé entre les citoyens et leurs élus, surtout face à un projet d’une telle envergure qui aurait mérité un vrai débat public.
Démagogie à l’état pur selon vous ?
Ce qui est drôle à ce moment-là, c’est de préciser que l’arrêté préfectoral qui encadre l’irrigation autorise un prélèvement de 1 million de m³ par an, alors que les agriculteurs n’en consomment actuellement que 300 000 m³ par an et que le plan d’eau contient aujourd’hui 1,5 million de m³ ! Doubler le stockage en eau est complètement inutile, c’est uniquement du marketing politique ! Lors de l’annonce de la vidange à la presse, ils avaient même invité de nombreux agriculteurs ardéchois. J’ai des collègues paysans qui travaillent à 100 km du barrage et qui ont été invités sur place pour soutenir le projet. On est dans le clientélisme, ça fonctionne, que veux-tu ! Tout est absurde dans cette histoire.
Attends, mais moi, naïf, je pensais que le monde agricole ardéchois, c’était surtout des baba cool producteurs de pélardons dans des exploitations miniatures… On m’aurait menti ?
On est loin des exploitations de la Beauce ! Les fermes sont encore à taille humaine chez nous ! Mais en Ardèche, comme dans beaucoup de départements, certains lobbies sont plus puissants que d’autres. Chez nous, le tourisme et l’agriculture occupent une place importante, et nous devons nous battre au quotidien pour faire entendre la voix des milieux aquatiques et des rivières, celles qui font RÉELLEMENT vivre tout le monde ! Beaucoup l’oublient, pris dans l’engrenage du productivisme…

Revenons à notre histoire : la « vidange expérimentale » est actée, une date est prévue, VOUS FAITES quoi à la FD ?
La FD a réagi très tôt en alertant l’opinion publique à travers une double page dans le Dauphiné Libéré quelques jours avant le drame avec « une alerte lancée par les pêcheurs ». Malheureusement, la plupart des gens n’y ont pas cru : "Encore ces écolos de pêcheurs...", tu vois le genre. Consciente de l’ampleur de la catastrophe à venir et forte des leçons tirées de précédentes affaires similaires mais de moindre ampleur, la Fédération a décidé de prendre les devants. Elle s’est dotée d’une avocate spécialisée en environnement, d’un avocat lobbyiste pour gérer la communication, et d’un huissier de justice mobilisable à tout moment.
Nous avons suivi la vidange de très près, présents sur place dès le début. Les premières heures semblaient maîtrisées : rien à signaler au cours du premier jour. Le bureau d’étude missionné suivait les constantes environnementales comme l’oxygène et les matières en suspension. Mais tout a basculé dans la nuit du 2 au 3 septembre. Nous étions encore sur place, tard dans la soirée, quand nous avons observé les premières mortalités dans le barrage. À ce moment-là, seule la vanne d’oxygénation fonctionnait, et le niveau de l’eau baissait progressivement.
Au petit matin, après une nuit d’ouverture de la vanne, c’était l’hécatombe, tout était mort. Des poissons sur les berges, partout, que ce soit dans le barrage ou dans la rivière, sur plusieurs kilomètres en aval.
Face à ce désastre, nous avons immédiatement mobilisé notre réseau technique, médiatique et politique puis contacté la gendarmerie, qui a été très réactive. De son côté, l’OFB (Office Français de la Biodiversité) a été plus difficile à mobiliser : il a fallu les relancer à plusieurs reprises avant qu’un agent ne se déplace pour effectuer quelques prélèvements.
C’est rageant de constater à quel point l’État se désengage de l’environnement en ne dotant pas l’OFB des moyens humains et matériels nécessaires. J’aurais tellement voulu voir cinq ou six agents équipés de matériel technique comme des drones pour évaluer l’ampleur de la pollution et mesurer la mortalité. Mais non, il a fallu compter quasiment que sur nous-mêmes. Nous avons fait intervenir notre huissier de justice pour attester d’une réalisation de nos prélèvements en conformité avec le protocole établi par le laboratoire. Ces données seront essentielles pour documenter la future plaidoirie. Aujourd’hui, l’enquête est menée par l’OFB en collaboration avec la gendarmerie. Nous attendons de voir les conclusions, mais ce désastre restera gravé dans nos mémoires comme un exemple de l’insuffisance des moyens alloués à la protection de nos milieux aquatiques.




Au-delà de la mortalité piscicole, les métaux lourds ont –ils refait surface ?
Maintenant, des dizaines de kilomètres en aval du barrage ont été lourdement impactés par les métaux lourds libérés lors de la crue qui a suivi la vidange. Ces sédiments contaminés, transportés par les eaux, posent un risque sérieux pour l’environnement et la santé publique. Prenons l’exemple du nickel, qui est présent en quantités particulièrement importantes : ce métal est connu pour son fort taux d’infiltration dans les sols acide, ce qui le rend susceptible de contaminer les nappes phréatiques. Après l’eau potable, ce n’est pas de notre ressort mais la question s’est rapidement posée, car cela représente une menace directe pour les populations locales.
Depuis cet automne, toutes les communes concernées ont été contraintes de mettre en place des prélèvements réguliers pour surveiller la qualité de leur eau potable. Malheureusement, ce type de pollution est caractérisé par une forte inertie. Les métaux lourds se déposent et restent dans les sédiments pendant de longues périodes, rendant les effets difficilement prévisibles et surtout durables... il est clair que ces métaux ne disparaîtront pas d’eux-mêmes. En attendant, les inquiétudes grandissent chez les habitants et certains agriculteurs, qui se demandent à juste titre si leur eau est toujours potable et si leurs terres ne risquent pas d’être contaminées à leur tour.
Et quel a été l’impact sur les populations locales ?
L’opinion publique, devant tous ces poissons morts visibles et puants, a forcément réagi en notre faveur. C’est un peu le même principe que lorsqu’un orque se retrouve bloqué dans la Seine, au Havre : tout le monde s’affole et s’indigne. Mais dès qu’il s’agit de phénomènes moins visibles, comme la mort quotidienne de milliers d’insectes ou la disparition progressive d’écrevisses allochtones, personne ne s’en préoccupe, parce que ça ne se voit pas. Pourtant, l’impact est bien plus dramatique.
Après la catastrophe, nous avons reçu de nombreux messages de soutien de la part des locaux. Ces élans d’émotion sont réconfortants, mais le problème, c’est qu’ils s’essoufflent vite. Quelques semaines après, l’attention est presque retombée, comme si rien ne s’était passé.
Aujourd’hui, un collectif de citoyens s’est constitué autour de l’association BEED (Biodiversité Eyrieux Environnement Développement). Cette association, qui réalise depuis de nombreuses années un travail remarquable, a redoublé d’efforts ces derniers mois pour répondre à cette catastrophe. Elle a été très active, en mobilisant des ressources et en sensibilisant la population aux enjeux liés à cet événement. Grâce à leur implication et leur ténacité, l’impact de cette tragédie reste un sujet de préoccupation pour une partie des habitants, mais il faut encore maintenir la pression pour que des mesures concrètes soient prises à long terme.

Quel est l’enjeu halieutique au niveau local ?
Aujourd’hui, on trouve pas mal de pêcheurs au brochet en float tube, des carpistes, et des pêcheurs au coup sur ce lac. Mais à la FD, nous devons avoir une vision à plus long terme. Notre objectif est clair : « ré »-ouvrir le débat sur la raison d’être de ce barrage et son utilité réelle. Et si possible, aboutir à son effacement. C’est un défi ambitieux, car il va falloir mener un travail de sensibilisation considérable, y compris au sein de notre propre réseau de pêcheurs.
Il faut que tout le monde comprenne que l’intérêt commun est de retrouver une rivière vivante, qui s’écoule librement, plutôt qu’un barrage inerte et sans vie. Les écosystèmes aquatiques fonctionnent bien mieux dans des environnements naturels, et la biodiversité y est bien plus riche. Ce serait une victoire non seulement pour les pêcheurs, mais aussi pour toute la vallée d’un point de vue touristique et économique. Nous devons convaincre que cette transition, bien que complexe, est bénéfique pour tous à long terme.
C’est tout le paradoxe de notre loisir : on se prévaut d’être des écolos sentinelles des milieux alors qu’en réalité, certains de nos pêcheurs doivent encore prendre conscience de la nécessité de milieux aquatiques sains, naturels et non impactants pour une pêche de loisir durable... Comment travaillez-vous à faire évoluer ces mentalités à la FD ?
Le projet de mandature du conseil d’administration est très clair sur ce sujet : faire monter en compétence les AAPPMA et les soutenir financièrement pour qu’elles puissent pleinement remplir leur rôle. C’est dans cet objectif que nous avons créé, sous l’impulsion du CA de la FD, quatre emplois "Les Pieds dans l’Eau". Ces postes sont occupés par des personnes qualifiées, mises à disposition des AAPPMA pour réaliser des animations, de l’éducation à l’environnement, du soutien administratif et des opérations techniques.
Nous pensons que le modèle actuel FD/AAPPMA, tel qu’il fonctionne aujourd’hui, atteint ses limites. Les milieux aquatiques et leurs habitants subissent des agressions répétées, amplifiées par les changements climatiques. Face à ces enjeux, il est essentiel de repenser notre organisation pour mieux protéger nos rivières.
Dans un monde idéal, il devrait y avoir une AAPPMA par grand ou moyen bassin versant – soit environ 15 en Ardèche – chacune dotée d’un salarié. Ces salariés assureraient un travail de terrain renforcé, et chaque AAPPMA serait représentée au conseil d’administration de la Fédération par un membre élu. Ainsi, toutes les AAPPMA disposeraient du même niveau d’information sur ce qui se passe au niveau fédéral, et chaque bassin bénéficierait d’un agent de terrain dédié, permettant une meilleure surveillance et une réactivité accrue en cas de problème.
C’est une idée qui mûrit en Ardèche depuis un certain temps déjà. Les Emplois "Les Pieds dans l’Eau" en sont les premières fondations. Si nous continuons sur cette voie, nous pourrons construire un modèle plus adapté, plus efficace, et plus résilient pour l’avenir de nos milieux aquatiques et des générations de pêcheurs à venir.
Bon, on a bien compris, ce que la FD demande, c’est de gommer ce mur en béton ?
La plainte déposée contre X a permis de déclencher une enquête et de commencer à établir les responsabilités de chacun. On sait que ce processus va prendre du temps, probablement 3 ou 4 ans avant d’arriver au jugement. Notre système d’archivage est parfaitement au point, et tous les chiffres, toutes les données collectées sont soigneusement conservées pour soutenir le dossier au pénal. C’est un prérequis indispensable si nous voulons obtenir gain de cause dans les années à venir.
Nous avons monté un dossier technique solide et faisons tout pour communiquer de manière dépassionnée sur le sujet. C’est essentiel pour garder de la crédibilité face aux élus, aux décideurs et au public.
En pratique, nous demandons clairement l’arasement de l’ouvrage. Quand on regarde les faits, le barrage n’est pas rentable en matière de production énergétique. Il n’y a aucune raison valable de le conserver : ni l’hydroélectricité, ni l’agriculture, ni le tourisme ne justifient son maintien. Même Gilbert Cochet, célèbre naturaliste et grand amoureux de la vallée de l’Eyrieux, le dit lui-même : ce barrage est l’exemple parfait de ce qu’il ne faut pas faire en matière d’infrastructure. Pour lui, c’est une "verrue insensée" dans le paysage.
Nous continuons donc à défendre l’idée de son effacement, avec des arguments clairs et fondés. L’objectif est d’agir dans l’intérêt des milieux aquatiques et des générations futures, en rendant à la vallée de l’Eyrieux son caractère naturel et sa vitalité

Encadré : Travaux soumis à autorisation / soumis à déclaration : nomenclature avec critères précis. Quand tu es en autorisation, l’étude préalable doit être plus conséquente, comme les mesures compensatoires. Là, à notre grande surprise, tous les seuils concernés par ces travaux sont inférieurs aux seuils d’autorisation… une vidange qui s’annonçait des plus périlleuses est passé seulement en « autorisation » devant la préfecture ! A titre de comparaison, nous avons été récemment appelés par un agriculteur pour sauver les poissons dans son plan d’eau avant vidange… lui a été soumis à autorisation !